Présentation de l'éditeur
Le grand romancier cubain Alejo Carpentier (1904-1980), de son premier à son dernier livre, a posé un regard sur l'Amérique latine et en a imposé une vision désormais classique dans un style ample, luxuriant, à l'image d'un continent que seul le Baroque pouvait exprimer.
De New York à l'Amazonie, le héros musicien du" Partage des eaux", dans une recherche identitaire, remonte le temps et redescend en lui dans une quête qui devient conquête de sa liberté. Face aux illusions fanées d'une Europe meurtrie par la guerre, le Nouveau Monde encore vierge s'érige en horizon mythique possible d'un renouveau des rêves humanistes.
A travers musiques, rythmes, mythes déchiffrés, sur les pas retrouvés d'une écriture baroque défrichée, ce livre est une invitation au voyage en Carpentier, dans l'espace américain et son expression.
Extrait du livre
ILE ENTRE LES ILES
Emeraude tombée dans la mer qui, depuis le centre intense de son vert, propagerait à l'infini ses molles ondes concentriques jusqu'aux plus subtils dégradés verdâtres finissant par se fondre et se confondre dans le bleu de l'eau, Cuba est entourée par la dentelle négligente des îles Bahamas, nonchalamment posées, avec des grâces de papillons éthérés, sur la mer des Antilles. Eau? Terre? Nuages? II est impossible, du haut de l'avion, de déterminer où finit la terre bleue et où commence l'onde verte, ce qui est nuage, et ce qui est matière. Iles immatérielles, vapeurs d'îles, évanescence d'îles sitôt vues qu'estompées, fins pétales nacrés qu'un souffle doux eût effeuillés mollement du cœur de la corolle cubaine pour lui faire une couronne ou un collier de rêve.
La perle bleue de la mer des Antilles
Cuba s'offre enfin à la vue, se dérobe aussitôt, douillettement emmitouflée dans le creux, dans l'écrin des nuages nacrés. Des souvenirs de vers de José Marti, de Guillén, des visions d'Alejo Carpentier, de Lezama -trop tard connus, trop tôt perdus-, des plaisanteries de l’ami Severo, affluent en désordre ; des échos lointains de nostalgiques habaneras, des images de Fidel, du Che, des interrogations d’aujourd’hui sur la Révolution d’hier au cœur de cette fleur... Cuba, espérée par l’esprit, rêvée par la culture, vécue tant de fois et sentie par la chaleur de la sympathie, ressentie par l’amitié avec tant d’artistes, de poètes, Cintio, Fina, Eliseo1... ; Cuba évoquée, fatalement, malgré tout, avec les yeux du cœur.
Vision de La Havane
La vapeur persistante d'un orage tropical baigne la ville dans une brume de rêve. Ne rêve-t-on pas d'ailleurs? Les ruses du décalage horaire nous font évoluer dans un autre univers, nébuleux.
La Havane est une ville intime et monumentale. Resserrée près du port défendu par deux fortins symétriques, raidis de menaces corsaires, la vieille ville se recueille autour de la place de la petite cathédrale, à la façade concave comme deux bras grand-ouverts accueillants. Alignement de demeures d'un baroque insolite de simplicité, presque austère, n'était-ce, sur le fronton pur de leurs nobles façades, le solfège diffus des folles vignes vierges et, aux portes, ces grilles arachnéennes qui roulent, enroulent et déroulent leurs entrelacs délicats d'harmonieuse végétation métallique. Voisin, voué à la promotion des jeunes artistes cubains, le Centro Cultural Alejo Carpentier, demeure coloniale au patio intérieur à galerie en bois peint, en bleu si frais : on y revoit les turbulents et rêveurs enfants, adolescents, jeunes gens rêvant d’un monde meilleur, du Siècle des Lumières.
Les vieux quartiers du port étagent leurs ruelles rectilignes qui semblent monter, doucement, vers le ciel. Souvent, on se croirait perdu dans quelque blanc village andalou, avec la perspective, raccourcie sur l'azur, de balcons saillants en bois tourné, de vérandas fermées de mystérieuses jalousies, et des oiseaux inscrits en solfège sur la portée des fils électriques. C’est bien La Ville aux colonnes dépeinte par cet architecte aussi que fut Alejo.
On déambule à l'ombre rêveuse d'arcades comme des paupières pudiquement baissées sous l'éclatant soleil des façades sous lesquelles donnent, fermés de grilles, d'obscurs corridors qui débouchent sur des jardins secrets que l'on devine en fond. Des grilles encore, des colonnades, des blasons parfois. Une Andalousie moins rigide, moins austère, qui aurait reçu l'inflexion alanguie du créole, la charmeuse nostalgie du mulâtre, la verdâtre patine, enfin, d'un air voluptueux ivre d'humidité. Sur les murs, les taches dégradées jouent la carte de la géographie et les fentes, le caprice des fleuves. Le plus humble mur gris semble se végétaliser par la grâce d'une atmosphère marine qui fait mêler parfois, aux rides du crépi, le paraphe des fleurs, aux efflorescences mousseuses des moisissures, la molle estompe des auréoles de rouille. La volonté de restauration de certains joyaux d’architecture est sensible mais semble parfois dramatiquement prise de vitesse par la décrépitude du temps, terrible, les cyclones, terrifiants, le manque de moyens, accablant.
On est arraché au charme colonial espagnol, nimbé de la mélancolie poignante des beautés menacées ou déjà ravagées, dès le Malecón, longue jetée-promenade qui borde la ville le long de la mer et offre en horizon brutal de géométrie, l'épure lointaine des gratte-ciels du Nuevo Vedado et, cahin-cahotant, de bric et de broc réparées avec une efficace et joyeuse ingéniosité carnavalesque, en cortège bruyant, brinquebalant, le défilé des voitures américaines des années 50 : le jazz à la sauce salsa.
Les quartiers plus intérieurs de Marianao, malgré les numéros et les lettres des rues perpendiculaires, plongent le visiteur dans une Rome antique, aux couleurs pastel, qui aurait conservé la grâce miraculeuse et les idéales proportions athéniennes : sur un ou deux étages, en longues perspectives nébuleuses, des maisons à colonnes ioniennes, corinthiennes, aux chapiteaux en triangle, avec des arcs, des arcades, des architraves et des entablements à frise, que l'on devine ou aperçoit à travers le nuage onirique d'une végétation de tamariniers et de palétuviers qui débordent en molles vagues sur la rue. Le règne néo-classique, néo-palladien, le rêve d’ordre venu d’ailleurs mais baroquisé par le climat farceur et la végétation facétieuse. Et les impitoyables outrages du temps et des temps.
Rues désertes aux heures chaudes du jour, silence minéral, géométrique, des tableaux de cités de Chirico ou des projets d'architectures de villes idéales de Piero della Francesca, lorsque ma compagne sort de l'ombre pour jauger un ensemble, se fige, et le bleu pur du ciel tombe sur ses épaules.
Benito Pelegrín
Critique in Autre Sud
Spécialiste du baroque et du néo-baroque contemporain (et le meilleur de Carpentier, écrit de lui Klaus Müller-Bergh dans la Revista iberoamericana), Benito Pelegrín publie cette étude sur le grand romancier cubain qu'ensemble nous avions rencontré, «au temps de nos études folles », dans le cadre des activités hispaniques de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence.
L'extraordinaire richesse du livre ne nous permet pas d’en rendre compte en ces lignes comme nous le souhaiterions. «L'écrivain cubain au regard d'Européen» qu'est Carpentier (« Le père breton, la mère russe : issus d'un finistère à l'autre de l'Europe, de l'extrême est à l'extrême ouest, large parenthèse embrassant le tissu de cultures, diverses et une à la fois: architecte l'un, professeur de langues l'autre ») ne pouvait que séduire Pelegrín, par sa personnalité hors du commun et une œuvre qui, du premier au dernier livre, «a posé un regard sur l'Amérique latine et en a imposé une vision désormais classique dans un style ample, luxuriant, à l'image d'un continent que seul le baroque pouvait exprimer».
Ce faisant, Pelegrín trouve un prétexte à son infinie méditation sur le baroque, excédant en fin de compte -aussi capitale et exemplaire soit-elle par ailleurs - l'œuvre du grand Cubain pour rejoindre son incessant travail (dont je me hasarderai à dire que c'est le mouvement de toute une vie) sert de plus en plus près les thèmes largement abordés en cet ouvrage majeur qu'est Figurations de l'infini dont j'ai parlé ailleurs en son temps mais qui demeure d'une brûlante actualité.
Précédée d'une introduction très colorée sur La Havane et Carpentier lui-même, la matière de cette étude se distribue en trois parties, « Rythmes américains », «Décrire l'Amérique », « Écrire l'Amérique», dans lesquelles sont successivement abordés, au travers de l'œuvre, les thèmes récurrents chers à Pelegrín: temps et tempo, musique, libération du rythme; puis l'usage du mythe (spécialement à travers de celui d'Orphée, bien entendu) et ses variations fécondes ; enfin la caractérisation aiguë d'un style qui devient métaphore grandiose de tout un continent.
Ramassant pour finir les divers éléments de son étude en gerbe, Benito Pelegrín constate que la phrase type de Carpentier se distribue dans un ordre très différent de l'ordre habituel du français en cela notamment qu'elle reste parfaitement ouverte. Il souligne son dire en citant une phrase exemplaire que, pour sa splendeur, nous donnerons en conclusion:
Rauques, mugissantes, tenues en longue note tombée de la hune, presque lugubres, sonnent les trompes de la nef qui vogue lentement, dans un tel vol de brume que du château de poupe on n'en devine pas la proue.
Jacques Lovichi , "Chroniques et notes", AUTRE SUD, juin 2004
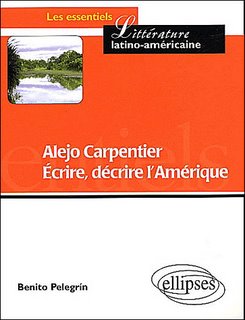
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire